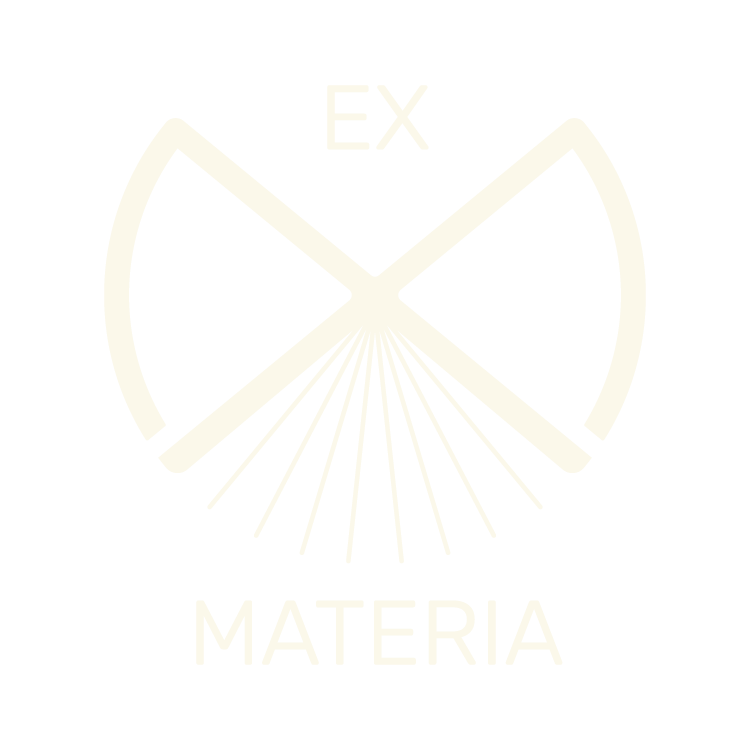Je vais parler ici de traitements de la vigne et non pas des fameux sulfites que l’on retrouve dans le vin (même s’il y a un lien, nous le verrons). Et quoi de mieux pour introduire ce sujet qu’une petite définition ? (ne répondez pas c’est une question purement rhétorique)
C’est quoi le soufre ?
Quelle que soit sa forme, poudre ou liquide, il s’agit quasiment systématiquement de l’ion sulfure (S2-) que l’on utilise pour traiter la vigne. Il peut y avoir des adjuvants qui entrent dans sa composition mais on ne va pas s’étendre sur le sujet. Il peut se présenter en sac de poudre jaune très volatile que l’on utilise pour le poudrage direct, ou bien sous forme de poudre plus grossière (granulé dispersible dans l’eau), ou encore sous forme liquide.
En ce qui concerne les méthodes d’application, on peut :
- soit pulvériser la poudre directement sur la plante (à la main ou avec un outil qui souffle la poudre)
- soit réaliser un mélange à base d’eau dans lequel on peut y ajouter du cuivre pour lutter contre le mildiou, de l’engrais foliaire qui pénètre par les feuilles, et des adjuvants comme de l’essence de terpène (pas de panique, c’est issu de la sève de conifère) qui permet aux produits de mieux coller aux feuille en cas pluie.
Tous ces produits entrent dans le cahier des charges du vin bio s’ils portent la mention UAB (Utilisable en Agriculture Biologique) et font partie de ce que l’on appelle les intrants. Les produits à base de soufre font partie de la famille des fongicides.
Alors que l’on soit bien clair, les vignes non traitées sont rarissimes (comme la plupart des cultures agricoles d’ailleurs). Il s’agira de petites parcelles de cépage plutôt résistant, comme la syrah par exemple, souvent isolées et avec des rendements très faibles (10 à 15 hl par hectare). Comme j’en ai parlé dans l’article sur le cuivre (si vous lisez les articles dans l’ordre, après si vous êtes des déglingos j’y peux rien…😁) il existe des alternatives plus « naturelles » mais leur efficacité me paraît trop faible lors des fortes pressions de maladie. Cela dit je ne m’étendrai pas sur le sujet car je ne le maîtrise pour le moment que très peu.
Et ça sert à quoi ?
Le soufre permet de lutter contre l’oïdium de la vigne qui est une maladie qui va affecter la qualité des raisins.
Le carignan est un cépage qui y est extrêmement sensible par exemple. Les recommandations sont d’effectuer un poudrage lors du stade des premières feuilles et du stade de la fleur. Ensuite, il convient d’utiliser un soufre mouillable en aspersion tous les 7 à 10 jours jusqu’à la fermeture de la grappe (ceci est un exemple de schéma de traitements, le mien pour tout dire) . Ouais, c’est un peu technique, alors voici une petite image qui va vous aider :
Bien sûr, dès qu’il pleut, il faut y retourner parce que le soufre est vite rincé par les averses.
On peut s’estimer à l’abri de l’oïdium à partir de la fermeture de la grappe, vers fin juillet, et donc arrêter de traiter. S’il ne pleut pas, ou peu, entre les derniers traitements et les vendanges, les couches successives de soufre qui se sont accumulées sur les raisins et qui vont donc se retrouver dans la cuve vont contribuer à créer les fameux sulfites présents dans le vin. Mais on est d’accord : dans des proportions ridicules comparé à un jus allégrement arrosé d’anhydride sulfureux pendant le processus de vinification (voir article correspondant).
Quels sont les effets indésirables du soufre ?
Alors comme on l’a déjà vu pour le cuivre rien ne sert de courir, il faut traiter au bon moment ! C’est pour cette raison qu’il existe des lettres d’information, tel que le bulletin de santé du végétal qui est édité toutes les semaines et rassemble un maximum d’éléments objectifs pour décider de quand traiter, avec quels produits, à quelles doses, etc…
En revanche, et contrairement au cuivre, le soufre n’est pas un métal lourd, il ne s’accumule donc pas dans les sols. Il a cependant un effet néfaste d’une manière générale sur l’ensemble du biotope de la vigne puisqu’il s’agit d’un fongicide non sélectif. Et ce n’est pas tout, le soufre à un autre inconvénient : il majore les effets de brûlure thermique lié aux rayons du soleil. Attention donc aux épisodes caniculaires !!! Une parade à ce désagrément peut consister à utiliser de la poudre disposée au pied du cep de vigne. Sous l’action du soleil, de la vapeur émane du soufre au sol et traite la plante mais ne la brûle pas. Cette technique était notamment utilisée au Maghreb. Elle n’est malheureusement pas compatible avec les régions venteuses.
D’où vient le soufre ?
Mais revenons à nos moutons. D’une manière très simplifiée et schématique, on peut obtenir du soufre de 2 façons (le même ion) :
- Soit on le ramasse, on en trouve particulièrement aux abords des volcans, dans des mines (il y en a eu près de Narbonne)
- soit on l’obtient par raffinage lors de la transformation du pétrole en carburant.
Alors là 2 écoles s’affrontent.
Les premiers, adeptes du soufre naturel, vantent les mérites d’un produit qui n’est pas issu de la pétrochimie, donc plus vertueux et également plus pur. C’est selon eux plus respectueux de la nature et de l’environnement. Ils s’orientent donc vers du soufre de mine ou volcanique.
Les seconds ne défendent pas nécessairement la pétrochimie mais ils achètent ce qu’ils trouvent chez leur revendeur phytosanitaire sans se soucier de la provenance. Parmi eux, certains font le choix d’un soufre issu de la pétrochimie.
Comment choisir ?
Pour choisir, il faut comprendre. Voici donc quelques éléments qui ont orienté ma prise de décision.
Pour le soufre volcanique, c’est socialement et humainement que les choses posent problème : les conditions d’extractions sont à vomir. Des mineurs indonésiens descendent dans les volcans, sans protection, pour ramasser le soufre à mains nues, pour 2$ par jour et dépassent rarement l’âge de 40 ans à cause de l’atmosphère toxique qu’ils respirent à longueur de journée.
Le soufre minier est aujourd’hui extrait grâce au procédé Frasch. Le principe est d’injecter de l’eau surchauffée à 165°C sous 25 à 30 bars de pression pour faire fondre le soufre (qui se liquéfie à 115°C), puis en injectant de l’air comprimé on parvient à faire remonter le soufre sous forme liquide. L’ennui c’est que la méthode utilise entre 3 000 et 38 000 litres d’eau par tonne de soufre (en fonction de la profondeur du gisement). Ce procédé est encore utilisé en Pologne et au Mexique. Il a constitué une véritable révolution au début du XXe siècle lors de son invention puisque l’on a pu s’affranchir des mineurs pour extraire le soufre.
Le soufre issu de la pétrochimie est, quant à lui, produit par les raffineries en quantité énorme tous les ans, et ce, qu’il soit utilisé ou non. En effet, cela fait partie du processus de raffinage des carburants. Je ne m’étendrai pas sur les pollutions liées à ces pratiques, beaucoup l’ont déjà fait et bien mieux que je ne le ferais moi même. Dans les années 1970 la pétrochimie a détrôné la méthode Frasch car moins coûteuse. Il existe également des usines qui raffinent du soufre sans produire de carburant.
Alors c’est vrai qu’entre acheter les poubelles des industriels de la pétrochimie, contribuer à l’exploitation de mineurs du tiers monde ou gaspiller nos ressources en eau, le choix n’est pas simple. Personnellement j’ai choisi de ne pas participer à l’exploitation d’êtres humains et de préserver les ressources en eau ; j’utilise donc du soufre issu de la pétrochimie. Cela ne me satisfait pas vraiment mais à ce jour, c’est le seul compromis que j’envisage. Je me penche sur les méthodes de traitements “alternatives” (voir article sur le cuivre) mais je ne maitrise pas encore assez le sujet pour pouvoir m’affranchir du soufre.